-
 Ambroise et la carriole
Ambroise et la carriole Ambroise Rabetaud, jeune voisin de Jean-Baptiste Boudeau, en ce lundi 18 février 1901, se hisse sur l'un des marchepieds de la voiture à cheval de Jean-Baptiste.
Il a neigé et la neige a tenu, comme on le dit familièrement : on en voit aussi bien sur les roues de la carriole, l'essieu, le frein, mais également sur les sabots de bois du jeune garçon âgé d'un peu plus de 9 ans. Celui-ci semble avoir froid, avec son écharpe bien nouée et serrée autour du cou, sa tête légèrement rentrée dans les épaules, les deux paires de chaussettes dans les sabots.
La toile jetée sur le contenu de la charrette, pour en protéger la marchandise, laisse néanmoins entrevoir un tonneau muni d'un robinet et trois autres récipients dont l'un coiffé- ou muni- d'un entonnoir, une bonbonne et un bidon. Jean-Baptiste Boudeau est avant tout épicier, et il doit livrer une partie de sa clientèle avec cette voiture à cheval.
Personnage : Ambroise Rabetaud
Boite B1 (Bfm Limoges)
-
 Tramway, boulevard Carnot
Tramway, boulevard Carnot Cette photographie prise en avril ou en mai 1900, représente une vue du tramway électrique de Limoges. Il s'agit d'une voiture de la ligne V (5) descendant le boulevard Carnot, en contrebas de la place de la République. A cette époque, une rangée d'arbres était plantée au dessus d'un escalier menant de la place au boulevard. On peut distinguer une publicité surmontant la voiture du tram, pour une marque de chocolat, Louit. Plusieurs passants animent cette vue, dont un groupe de trois bavardant ; une des dames se protégeant du soleil avec son ombrelle. C'est une des premières, peut-être même la première photographie de Jean-Baptiste Boudeau, réalisée alors qu'il a 19 ans. Son intérêt pour tous les moyens de transport, pour la modernité transparaît ici très clairement.
Boite B1 (Bfm Limoges)
-
 Gay-Lussac et son cheval
Gay-Lussac et son cheval « Boudeau immortalise ici une scène presque banale de l’univers châtelain. Un membre de la famille Gay-Lussac monte un superbe cheval de selle. L’image est parfaitement centrée sur le cavalier et sa monture. En arrière-plan se dresse une tour du château du Landeix, une des quatre demeures champêtres des descendants du célèbre chimiste. Sur la gauche, un personnage apparemment secondaire joue un rôle essentiel : père du cavalier ou régisseur de la propriété, il incarne une figure d’autorité ou, pour le moins, de conseil. Le jeune homme se montre attentif et le cheval obéissant. L’univers châtelain est décidément un monde d’apparences et de hiérarchies. »
Philippe Grandcoing
Personnages : Louis Gay-Lussac
Boîte 165 (Bfm Limoges)
-
 Les buveurs d'absinthe
Les buveurs d'absinthe Photographie prise le mardi 11 mai 1909, sur les bords du Taurion, probablement à Bourganeuf en Creuse. Nous possédons à la fois un tirage encadré et la plaque originale. Ces deux jeunes gens posent fièrement dans une étonnante symétrie et ressemblance. Mêmes tabliers blancs, mêmes torses nus, mêmes postures du bras gauche tenant une cigarette. Sur la table pliante bien campée, deux verres à pied, avec les cuillères à absinthe trouées, un sucrier, une carafe d'eau et bien-sûr la bouteille d'absinthe elle-même. La rangée d'arbres – quatre – que l'on voit en enfilade et qui les sépare sur la photographie crée la profondeur de champ. On distingue à droite une passerelle en bois, et un petit bâtiment vraisemblablement construit sur l'autre rive. La plaque au plan sensiblement plus large laisse supposer que, hors champ à droite, se trouve une construction.
Personnages : Gabriel Barry et Charles Pradeloup
Boîte 17 (Bfm Limoges)
-
 Dans mon jardin
Dans mon jardin Nous sommes dans un des jardins qui se trouvent entre les maisons du bourg de Saint-Priest-Taurion et la Vienne, durant l'hiver 1901.
Jean-Baptiste Boudeau qui vit là depuis sa naissance, y réalise ses premières photographies. Nous sommes vraisemblablement dans le jardin de l'épicerie Boudeau, ou un autre y attenant.
Il y a du linge qui sèche sur un fil à linge et une rambarde, un panier, celui-là même qui a peut-être transporté le linge mouillé. Derrière le panier, un chat se tient dans l'embrasure de la porte.
A gauche, devant le mur, ces trois personnages font face au soleil et au photographe. Ce soleil d'hiver, souvent éblouissant, qui projette les ombres sur le mur, mais aussi l'ombre de l'arbuste sur les vêtements de la jeune femme. Elle plisse les yeux, et délicatement de sa main gauche gantée de noir tient une écharpe noire et un objet emballé. Sa main droite est à demi plongée dans la poche avant de sa robe. L'enfant, il s'agit d'un garçon, lève la tête, car le jeune homme derrière lui, lui tient le menton de sa main droite.
Personnages : Catherine Ventenat, Paul Carroit, Emile Courgnaud
Boite B11 (Bfm Limoges)
-
 Chez le photographe
Chez le photographe Prise dans un décor de fausse rocaille, en vogue à la fin du 19ème siècle, au sein du studio de Jean Faissat, cette photographie nous montre les deux amis, Jean-Baptiste Boudeau et Émile Goumy âgés d'environ 19 ans. Nous sommes à Limoges, 19 rue du Clocher, où le photographe Faissat s'est établi en 1893. Jean-Baptiste s’approvisionne chez lui, et utilise un objectif de marque Faissat.
Les deux jeunes gens posent devant une toile peinte, dont on voit le pli, en bas, dans un décor factice, face au photographe favori de Jean-Baptiste Boudeau. Lui est au centre de la photo, à l'aise, souriant et décontracté, tandis que son ami est debout, en retrait, dans une allure un peu martiale. Néanmoins, il pose une main amicale sur l'épaule de Jean-Baptiste.
A gauche, on devine l'encorbellement d'une cheminée ou d'un meuble. C'est dans ce même studio, que cinq ans plus tard, Jean-Baptiste posera avec son épouse, Marguerite Leblanc.
Personnages : Émile Goumy et Jean-Baptiste Boudeau
Boite B1
-
 Sculptures du Petit Séminaire de Brive
Sculptures du Petit Séminaire de Brive Gravure extraite de " En Limousin" recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage.
Ces sculptures proviennent de l'hôtel de Labenche, un des plus beaux hôtels particuliers renaissance de la région. Construit en 1540. Acheté en 1829 par l'évêque de Tulle pour y installer un petit séminaire vers 1850, il est ensuite devenu propriété de la ville de Brive-la-Gaillarde qui y installa le musée municipal dont le premier conservateur fut... Ernest Rupin ( de 1884 à 1909).
Cette gravure fut initialement publiée dans le Bulletin de la société archéologique de Brive
cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)
-
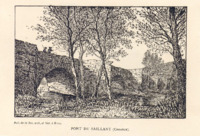 Le pont du Saillant
Le pont du Saillant Gravure extraite de " En Limousin, recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage".
Edifié au XVIème siècle, le pont du Saillant est situé à cheval sur les communes de Voutezac et d'Allassac, (les habitants parlent encore du « Saillant d'Allassac » et du « Saillant de Voutezac »), enjambant la Vézère. Il est composé de six arches, deux sur Allassac et les autres sur Voutezac. Il a bénéficié d'une protection par les Monuments Historique en 1969.
Cette gravure fut initialement publiée dans le Bulletin de la société archéologique de Brive
cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)
-
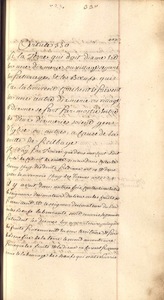 Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, deuxième partie
Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, deuxième partie Deuxième partie de l'article 330 à la fin.
Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le Code Civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret.
Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur.
cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)
-
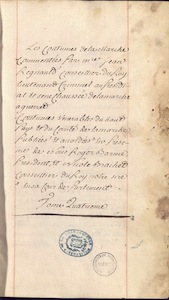 Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, première partie
Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, première partie Première partie de l'article 286 à l'article 329.
Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret.
Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur.
cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)
-
 Marcelle Tinayre : biographie critique suivie d'opinions, d'un autographe et d'une bibliographie
Marcelle Tinayre : biographie critique suivie d'opinions, d'un autographe et d'une bibliographie Biographie critique écrite par un journaliste du vivant de l'auteure (elle a alors 39 ans) : elle a écrit ses plus grands romans (Hellé, La Maison du Péché, la Rebelle...).
cote : MAG.P LIM E699 (Bfm Limoges)
-
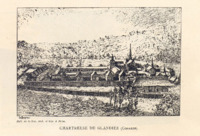 la Chartreuse du Glandier
la Chartreuse du Glandier Gravure extraite de " En Limousin, recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage".
Situé à l'ouest de la Corrèze, sur le territoire de la commune de Beyssac au milieu d'une forêt de chênes (d'où son nom), ce monastère est, avec celui de Mortemart (Haute-Vienne), le seul établissement cartusien (relatif aux Chartreux, dont la règle est le silence et la contemplation) du Limousin. Il fut fondé en 1219 par Archambaud VI. La Chartreuse a connu deux périodes de fonctionnement conventuel : la première entre 1219 et 1789, et la seconde entre 1860 et 1901. Confisqué par deux fois par l'État, le monastère a connu de nombreux avatars (hôpital militaire, centre de colonie de vacances, sanatorium...)
Cette gravure fut initialement publiée dans le Bulletin de la société archéologique de Brive
cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)
-
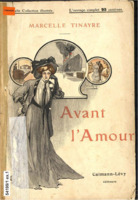 Avant l'amour
Avant l'amour Premier roman de Marcelle Tinayre publié pour la première fois en 1897.
Née à Tulle en 1870, Marcelle Tinayre est une femme de lettres
qui a marqué la Belle Époque, à la charnière des XIXe et XXe siècles.
Fille et belle-fille de femmes engagées, Marcelle Tinayre connaît, après la publication de ses premières nouvelles en 1893, un succès rapide dès ce premier roman, "Avant l’amour ". Elle publie par la suite "Hellé", couronné par l’Académie française.
Parmi ses autres œuvres, il convient de citer "la Rebelle", paru en 1905, dans lequel elle aborde l’avortement ; elle parle de grossesses hors-mariage dans son second roman « corrézien » la "Vie amoureuse de François Barbazanges" puis "l’Ombre de l’amour" (1909), dont l’action se déroule principalement à Gimel-les-Cascades. séduite par ce bourg - à l'instar de Gaston Vuillier - qu’elle découvre au tout début du XXe siècle parallèlement à ses retrouvailles avec sa ville natale. Collaboratrice du journal féministe la Fronde, Marcelle Tinayre est l’un des premiers membres du jury du futur prix Femina et en sera la présidente en 1908.
cote : MAG.P LIM 54199/1 (Bfm Limoges)
-
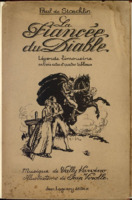 La Fiancée du diable : légende limousine en trois actes et quatre tableaux
La Fiancée du diable : légende limousine en trois actes et quatre tableaux d'après une nouvelle de Louis de Beaugency .
"La Fiancée du Diable a été représentée pour la première fois sur la scène du théâtre municipal de Limoges le 11 janvier 1941."
Livret complet et partitions en fin de recueil.
Wally Karveno, née Loewenthal est une compositrice comédienne et poétesse qui vécut un temps réfugiée à Limoges pendant la guerre avant d'être internée au camp de Gurs en France en 1941. Elle laisse une oeuvre essentiellement écrite pour piano.
Ami de Robert Margerit, du porcelainier Jacques Bernardaud, de l'éditeur Jean Lagueny, etc., Jean Virolle, formé aux beaux-arts de Limoges, est un artiste à plusieurs facettes surtout connu pour ses illustrations de presse et revues.
cote : MAG.P LIM 36654
-
 La maison Treilhard, Brive
La maison Treilhard, Brive Gravure extraite de " En Limousin, recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage".
La maison Treilhard, un bel hôtel particulier du XVIe siècle, fut la maison natale de J.-B. Treilhard (1742-1810), avocat, homme politique, principal rédacteur du code civil. Il est inhumé au Panthéon. Cet immeuble a appartenu aussi à une congrégation des frères prêcheurs.
On voit encore la belle tour d’escalier en vis et la tourelle en encorbellement qui s’y accroche.
Cette gravure fut initialement publiée dans le Bulletin de la société archéologique de Brive
cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)
-
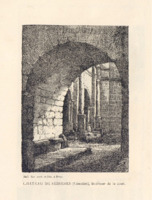 Cour du château de Sédières, Corrèze
Cour du château de Sédières, Corrèze Gravure extraite de " En Limousin" recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage.
Manoir fortifié construit au XVe siècle, il devient au XVIe siècle une demeure de plaisance remaniée de style Renaissance italienne par Dominique de Sédières de retour des campagnes d'Italie. Au XVIIe siècle le château se dote de jardins à la française grâce à la famille Lantillac, nouveaux héritiers des lieux. Abandonné puis pillé à la Révolution, le château est restauré en 1861 suivant les plans de Viollet-le-Duc.
Cette gravure fut initialement publiée dans le Bulletin de la société archéologique de Brive
cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)
-
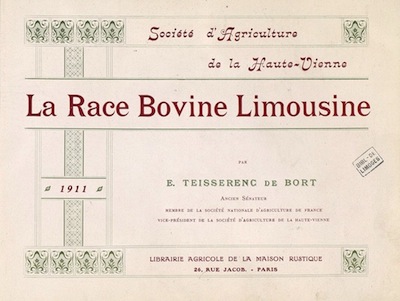 La Race bovine limousine
La Race bovine limousine Catalogue illustré des plus beaux spécimens, lieux d'élevage, prix, exposition, etc. précédé d'une courte présentation.
Edmond Teisserenc de Bort, sénateur de la Haute-Vienne de 1895 à 1909 consacra la majeure partie de sa vie à la promotion de la race bovine limousine. Il fut président de la société d'agriculture de Limoges, président du syndicat des agriculteurs de la Haute-Vienne et vice-président du syndicat de la race bovine limousine.
cote : MAG.P LIM 42885 (Bfm Limoges)
-
 Le logis de Loyac, Tulle
Le logis de Loyac, Tulle Gravure extraite de " En Limousin" recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage.
Le logis de Loyac appelée aussi "maison de l'abbé" fut construit aux XVe et XVIe siècles. Remarquable par l'élégance de sa façade, cette dernière, reconnaissable à ses tourelles, associe le style gothique flamboyant aux ornementations Renaissance.
Cette gravure fut initialement publiée dans "Le vieux Tulle de René Fage.
cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)
-
 Lexique limousin d'après les oeuvres de Joseph Roux
Lexique limousin d'après les oeuvres de Joseph Roux Dans la préface à l'ouvrage, Raymond Laborde précise : " On trouvera donc ici le vrai dialecte limousin et la plupart des mots réapparaitront avec toute leur couleur et leur saveur dégagés de la chrysalide "patoise"[...] Qu'on ne s'attende pas à quelque chose d'impeccable. Notre langue, si longtemps souveraine, a été d'une richesse incomparable. Nous ne pouvions pas avoir la prétention de la faire connaître du premier coup".
Joseph Roux (1834-1905) félibre majoral limousin, chanoine de la cathédrale de Tulle, fondateur de la revue occitane Lemouzi est aujourd'hui salué avec respect dans toute l'Occitanie. Auteur d'une oeuvre littéraire riche (certaines de ses œuvres sont de véritables chansons de geste) et d'une Grammaire limousine, il entreprend un dictionnaire de la langue d'oc qui demeurera inédit à sa mort.
cote : MAG.P LIM 33684 (Bfm Limoges)
-
 Maison à Uzerche, Corrèze
Maison à Uzerche, Corrèze Gravure extraite de " En Limousin, recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage".
Cette maison est connue aujourd'hui sous le nom de Château Pontier. C'est un bâtiment construit au 16e siècle par la famille Pontier qui avait quitté Aix-en-Provence à cause des guerres de Religion. Construit à l'emplacement d'un château antérieur, le bâtiment est constitué d' un corps de logis rectangulaire flanqué, du côté de la Vézère, de deux tourelles circulaires d'angle.
Cette gravure fut initialement publiée dans le Bulletin de la société archéologique de Brive
cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)
 Ambroise et la carriole Ambroise Rabetaud, jeune voisin de Jean-Baptiste Boudeau, en ce lundi 18 février 1901, se hisse sur l'un des marchepieds de la voiture à cheval de Jean-Baptiste. Il a neigé et la neige a tenu, comme on le dit familièrement : on en voit aussi bien sur les roues de la carriole, l'essieu, le frein, mais également sur les sabots de bois du jeune garçon âgé d'un peu plus de 9 ans. Celui-ci semble avoir froid, avec son écharpe bien nouée et serrée autour du cou, sa tête légèrement rentrée dans les épaules, les deux paires de chaussettes dans les sabots. La toile jetée sur le contenu de la charrette, pour en protéger la marchandise, laisse néanmoins entrevoir un tonneau muni d'un robinet et trois autres récipients dont l'un coiffé- ou muni- d'un entonnoir, une bonbonne et un bidon. Jean-Baptiste Boudeau est avant tout épicier, et il doit livrer une partie de sa clientèle avec cette voiture à cheval. Personnage : Ambroise Rabetaud Boite B1 (Bfm Limoges)
Ambroise et la carriole Ambroise Rabetaud, jeune voisin de Jean-Baptiste Boudeau, en ce lundi 18 février 1901, se hisse sur l'un des marchepieds de la voiture à cheval de Jean-Baptiste. Il a neigé et la neige a tenu, comme on le dit familièrement : on en voit aussi bien sur les roues de la carriole, l'essieu, le frein, mais également sur les sabots de bois du jeune garçon âgé d'un peu plus de 9 ans. Celui-ci semble avoir froid, avec son écharpe bien nouée et serrée autour du cou, sa tête légèrement rentrée dans les épaules, les deux paires de chaussettes dans les sabots. La toile jetée sur le contenu de la charrette, pour en protéger la marchandise, laisse néanmoins entrevoir un tonneau muni d'un robinet et trois autres récipients dont l'un coiffé- ou muni- d'un entonnoir, une bonbonne et un bidon. Jean-Baptiste Boudeau est avant tout épicier, et il doit livrer une partie de sa clientèle avec cette voiture à cheval. Personnage : Ambroise Rabetaud Boite B1 (Bfm Limoges) Tramway, boulevard Carnot Cette photographie prise en avril ou en mai 1900, représente une vue du tramway électrique de Limoges. Il s'agit d'une voiture de la ligne V (5) descendant le boulevard Carnot, en contrebas de la place de la République. A cette époque, une rangée d'arbres était plantée au dessus d'un escalier menant de la place au boulevard. On peut distinguer une publicité surmontant la voiture du tram, pour une marque de chocolat, Louit. Plusieurs passants animent cette vue, dont un groupe de trois bavardant ; une des dames se protégeant du soleil avec son ombrelle. C'est une des premières, peut-être même la première photographie de Jean-Baptiste Boudeau, réalisée alors qu'il a 19 ans. Son intérêt pour tous les moyens de transport, pour la modernité transparaît ici très clairement. Boite B1 (Bfm Limoges)
Tramway, boulevard Carnot Cette photographie prise en avril ou en mai 1900, représente une vue du tramway électrique de Limoges. Il s'agit d'une voiture de la ligne V (5) descendant le boulevard Carnot, en contrebas de la place de la République. A cette époque, une rangée d'arbres était plantée au dessus d'un escalier menant de la place au boulevard. On peut distinguer une publicité surmontant la voiture du tram, pour une marque de chocolat, Louit. Plusieurs passants animent cette vue, dont un groupe de trois bavardant ; une des dames se protégeant du soleil avec son ombrelle. C'est une des premières, peut-être même la première photographie de Jean-Baptiste Boudeau, réalisée alors qu'il a 19 ans. Son intérêt pour tous les moyens de transport, pour la modernité transparaît ici très clairement. Boite B1 (Bfm Limoges) Gay-Lussac et son cheval « Boudeau immortalise ici une scène presque banale de l’univers châtelain. Un membre de la famille Gay-Lussac monte un superbe cheval de selle. L’image est parfaitement centrée sur le cavalier et sa monture. En arrière-plan se dresse une tour du château du Landeix, une des quatre demeures champêtres des descendants du célèbre chimiste. Sur la gauche, un personnage apparemment secondaire joue un rôle essentiel : père du cavalier ou régisseur de la propriété, il incarne une figure d’autorité ou, pour le moins, de conseil. Le jeune homme se montre attentif et le cheval obéissant. L’univers châtelain est décidément un monde d’apparences et de hiérarchies. » Philippe Grandcoing Personnages : Louis Gay-Lussac Boîte 165 (Bfm Limoges)
Gay-Lussac et son cheval « Boudeau immortalise ici une scène presque banale de l’univers châtelain. Un membre de la famille Gay-Lussac monte un superbe cheval de selle. L’image est parfaitement centrée sur le cavalier et sa monture. En arrière-plan se dresse une tour du château du Landeix, une des quatre demeures champêtres des descendants du célèbre chimiste. Sur la gauche, un personnage apparemment secondaire joue un rôle essentiel : père du cavalier ou régisseur de la propriété, il incarne une figure d’autorité ou, pour le moins, de conseil. Le jeune homme se montre attentif et le cheval obéissant. L’univers châtelain est décidément un monde d’apparences et de hiérarchies. » Philippe Grandcoing Personnages : Louis Gay-Lussac Boîte 165 (Bfm Limoges) Les buveurs d'absinthe Photographie prise le mardi 11 mai 1909, sur les bords du Taurion, probablement à Bourganeuf en Creuse. Nous possédons à la fois un tirage encadré et la plaque originale. Ces deux jeunes gens posent fièrement dans une étonnante symétrie et ressemblance. Mêmes tabliers blancs, mêmes torses nus, mêmes postures du bras gauche tenant une cigarette. Sur la table pliante bien campée, deux verres à pied, avec les cuillères à absinthe trouées, un sucrier, une carafe d'eau et bien-sûr la bouteille d'absinthe elle-même. La rangée d'arbres – quatre – que l'on voit en enfilade et qui les sépare sur la photographie crée la profondeur de champ. On distingue à droite une passerelle en bois, et un petit bâtiment vraisemblablement construit sur l'autre rive. La plaque au plan sensiblement plus large laisse supposer que, hors champ à droite, se trouve une construction. Personnages : Gabriel Barry et Charles Pradeloup Boîte 17 (Bfm Limoges)
Les buveurs d'absinthe Photographie prise le mardi 11 mai 1909, sur les bords du Taurion, probablement à Bourganeuf en Creuse. Nous possédons à la fois un tirage encadré et la plaque originale. Ces deux jeunes gens posent fièrement dans une étonnante symétrie et ressemblance. Mêmes tabliers blancs, mêmes torses nus, mêmes postures du bras gauche tenant une cigarette. Sur la table pliante bien campée, deux verres à pied, avec les cuillères à absinthe trouées, un sucrier, une carafe d'eau et bien-sûr la bouteille d'absinthe elle-même. La rangée d'arbres – quatre – que l'on voit en enfilade et qui les sépare sur la photographie crée la profondeur de champ. On distingue à droite une passerelle en bois, et un petit bâtiment vraisemblablement construit sur l'autre rive. La plaque au plan sensiblement plus large laisse supposer que, hors champ à droite, se trouve une construction. Personnages : Gabriel Barry et Charles Pradeloup Boîte 17 (Bfm Limoges) Dans mon jardin Nous sommes dans un des jardins qui se trouvent entre les maisons du bourg de Saint-Priest-Taurion et la Vienne, durant l'hiver 1901. Jean-Baptiste Boudeau qui vit là depuis sa naissance, y réalise ses premières photographies. Nous sommes vraisemblablement dans le jardin de l'épicerie Boudeau, ou un autre y attenant. Il y a du linge qui sèche sur un fil à linge et une rambarde, un panier, celui-là même qui a peut-être transporté le linge mouillé. Derrière le panier, un chat se tient dans l'embrasure de la porte. A gauche, devant le mur, ces trois personnages font face au soleil et au photographe. Ce soleil d'hiver, souvent éblouissant, qui projette les ombres sur le mur, mais aussi l'ombre de l'arbuste sur les vêtements de la jeune femme. Elle plisse les yeux, et délicatement de sa main gauche gantée de noir tient une écharpe noire et un objet emballé. Sa main droite est à demi plongée dans la poche avant de sa robe. L'enfant, il s'agit d'un garçon, lève la tête, car le jeune homme derrière lui, lui tient le menton de sa main droite. Personnages : Catherine Ventenat, Paul Carroit, Emile Courgnaud Boite B11 (Bfm Limoges)
Dans mon jardin Nous sommes dans un des jardins qui se trouvent entre les maisons du bourg de Saint-Priest-Taurion et la Vienne, durant l'hiver 1901. Jean-Baptiste Boudeau qui vit là depuis sa naissance, y réalise ses premières photographies. Nous sommes vraisemblablement dans le jardin de l'épicerie Boudeau, ou un autre y attenant. Il y a du linge qui sèche sur un fil à linge et une rambarde, un panier, celui-là même qui a peut-être transporté le linge mouillé. Derrière le panier, un chat se tient dans l'embrasure de la porte. A gauche, devant le mur, ces trois personnages font face au soleil et au photographe. Ce soleil d'hiver, souvent éblouissant, qui projette les ombres sur le mur, mais aussi l'ombre de l'arbuste sur les vêtements de la jeune femme. Elle plisse les yeux, et délicatement de sa main gauche gantée de noir tient une écharpe noire et un objet emballé. Sa main droite est à demi plongée dans la poche avant de sa robe. L'enfant, il s'agit d'un garçon, lève la tête, car le jeune homme derrière lui, lui tient le menton de sa main droite. Personnages : Catherine Ventenat, Paul Carroit, Emile Courgnaud Boite B11 (Bfm Limoges) Chez le photographe Prise dans un décor de fausse rocaille, en vogue à la fin du 19ème siècle, au sein du studio de Jean Faissat, cette photographie nous montre les deux amis, Jean-Baptiste Boudeau et Émile Goumy âgés d'environ 19 ans. Nous sommes à Limoges, 19 rue du Clocher, où le photographe Faissat s'est établi en 1893. Jean-Baptiste s’approvisionne chez lui, et utilise un objectif de marque Faissat. Les deux jeunes gens posent devant une toile peinte, dont on voit le pli, en bas, dans un décor factice, face au photographe favori de Jean-Baptiste Boudeau. Lui est au centre de la photo, à l'aise, souriant et décontracté, tandis que son ami est debout, en retrait, dans une allure un peu martiale. Néanmoins, il pose une main amicale sur l'épaule de Jean-Baptiste. A gauche, on devine l'encorbellement d'une cheminée ou d'un meuble. C'est dans ce même studio, que cinq ans plus tard, Jean-Baptiste posera avec son épouse, Marguerite Leblanc. Personnages : Émile Goumy et Jean-Baptiste Boudeau Boite B1
Chez le photographe Prise dans un décor de fausse rocaille, en vogue à la fin du 19ème siècle, au sein du studio de Jean Faissat, cette photographie nous montre les deux amis, Jean-Baptiste Boudeau et Émile Goumy âgés d'environ 19 ans. Nous sommes à Limoges, 19 rue du Clocher, où le photographe Faissat s'est établi en 1893. Jean-Baptiste s’approvisionne chez lui, et utilise un objectif de marque Faissat. Les deux jeunes gens posent devant une toile peinte, dont on voit le pli, en bas, dans un décor factice, face au photographe favori de Jean-Baptiste Boudeau. Lui est au centre de la photo, à l'aise, souriant et décontracté, tandis que son ami est debout, en retrait, dans une allure un peu martiale. Néanmoins, il pose une main amicale sur l'épaule de Jean-Baptiste. A gauche, on devine l'encorbellement d'une cheminée ou d'un meuble. C'est dans ce même studio, que cinq ans plus tard, Jean-Baptiste posera avec son épouse, Marguerite Leblanc. Personnages : Émile Goumy et Jean-Baptiste Boudeau Boite B1 Sculptures du Petit Séminaire de Brive Gravure extraite de " En Limousin" recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage. Ces sculptures proviennent de l'hôtel de Labenche, un des plus beaux hôtels particuliers renaissance de la région. Construit en 1540. Acheté en 1829 par l'évêque de Tulle pour y installer un petit séminaire vers 1850, il est ensuite devenu propriété de la ville de Brive-la-Gaillarde qui y installa le musée municipal dont le premier conservateur fut... Ernest Rupin ( de 1884 à 1909). Cette gravure fut initialement publiée dans le Bulletin de la société archéologique de Brive cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)
Sculptures du Petit Séminaire de Brive Gravure extraite de " En Limousin" recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage. Ces sculptures proviennent de l'hôtel de Labenche, un des plus beaux hôtels particuliers renaissance de la région. Construit en 1540. Acheté en 1829 par l'évêque de Tulle pour y installer un petit séminaire vers 1850, il est ensuite devenu propriété de la ville de Brive-la-Gaillarde qui y installa le musée municipal dont le premier conservateur fut... Ernest Rupin ( de 1884 à 1909). Cette gravure fut initialement publiée dans le Bulletin de la société archéologique de Brive cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)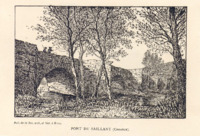 Le pont du Saillant Gravure extraite de " En Limousin, recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage". Edifié au XVIème siècle, le pont du Saillant est situé à cheval sur les communes de Voutezac et d'Allassac, (les habitants parlent encore du « Saillant d'Allassac » et du « Saillant de Voutezac »), enjambant la Vézère. Il est composé de six arches, deux sur Allassac et les autres sur Voutezac. Il a bénéficié d'une protection par les Monuments Historique en 1969. Cette gravure fut initialement publiée dans le Bulletin de la société archéologique de Brive cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)
Le pont du Saillant Gravure extraite de " En Limousin, recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage". Edifié au XVIème siècle, le pont du Saillant est situé à cheval sur les communes de Voutezac et d'Allassac, (les habitants parlent encore du « Saillant d'Allassac » et du « Saillant de Voutezac »), enjambant la Vézère. Il est composé de six arches, deux sur Allassac et les autres sur Voutezac. Il a bénéficié d'une protection par les Monuments Historique en 1969. Cette gravure fut initialement publiée dans le Bulletin de la société archéologique de Brive cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)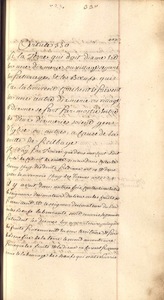 Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, deuxième partie Deuxième partie de l'article 330 à la fin. Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le Code Civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)
Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, deuxième partie Deuxième partie de l'article 330 à la fin. Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le Code Civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)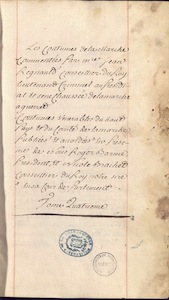 Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, première partie Première partie de l'article 286 à l'article 329. Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)
Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, première partie Première partie de l'article 286 à l'article 329. Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) Marcelle Tinayre : biographie critique suivie d'opinions, d'un autographe et d'une bibliographie Biographie critique écrite par un journaliste du vivant de l'auteure (elle a alors 39 ans) : elle a écrit ses plus grands romans (Hellé, La Maison du Péché, la Rebelle...). cote : MAG.P LIM E699 (Bfm Limoges)
Marcelle Tinayre : biographie critique suivie d'opinions, d'un autographe et d'une bibliographie Biographie critique écrite par un journaliste du vivant de l'auteure (elle a alors 39 ans) : elle a écrit ses plus grands romans (Hellé, La Maison du Péché, la Rebelle...). cote : MAG.P LIM E699 (Bfm Limoges)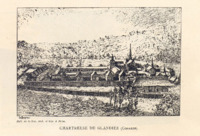 la Chartreuse du Glandier Gravure extraite de " En Limousin, recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage". Situé à l'ouest de la Corrèze, sur le territoire de la commune de Beyssac au milieu d'une forêt de chênes (d'où son nom), ce monastère est, avec celui de Mortemart (Haute-Vienne), le seul établissement cartusien (relatif aux Chartreux, dont la règle est le silence et la contemplation) du Limousin. Il fut fondé en 1219 par Archambaud VI. La Chartreuse a connu deux périodes de fonctionnement conventuel : la première entre 1219 et 1789, et la seconde entre 1860 et 1901. Confisqué par deux fois par l'État, le monastère a connu de nombreux avatars (hôpital militaire, centre de colonie de vacances, sanatorium...) Cette gravure fut initialement publiée dans le Bulletin de la société archéologique de Brive cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)
la Chartreuse du Glandier Gravure extraite de " En Limousin, recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage". Situé à l'ouest de la Corrèze, sur le territoire de la commune de Beyssac au milieu d'une forêt de chênes (d'où son nom), ce monastère est, avec celui de Mortemart (Haute-Vienne), le seul établissement cartusien (relatif aux Chartreux, dont la règle est le silence et la contemplation) du Limousin. Il fut fondé en 1219 par Archambaud VI. La Chartreuse a connu deux périodes de fonctionnement conventuel : la première entre 1219 et 1789, et la seconde entre 1860 et 1901. Confisqué par deux fois par l'État, le monastère a connu de nombreux avatars (hôpital militaire, centre de colonie de vacances, sanatorium...) Cette gravure fut initialement publiée dans le Bulletin de la société archéologique de Brive cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)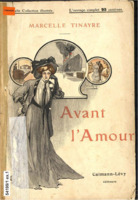 Avant l'amour Premier roman de Marcelle Tinayre publié pour la première fois en 1897. Née à Tulle en 1870, Marcelle Tinayre est une femme de lettres qui a marqué la Belle Époque, à la charnière des XIXe et XXe siècles. Fille et belle-fille de femmes engagées, Marcelle Tinayre connaît, après la publication de ses premières nouvelles en 1893, un succès rapide dès ce premier roman, "Avant l’amour ". Elle publie par la suite "Hellé", couronné par l’Académie française. Parmi ses autres œuvres, il convient de citer "la Rebelle", paru en 1905, dans lequel elle aborde l’avortement ; elle parle de grossesses hors-mariage dans son second roman « corrézien » la "Vie amoureuse de François Barbazanges" puis "l’Ombre de l’amour" (1909), dont l’action se déroule principalement à Gimel-les-Cascades. séduite par ce bourg - à l'instar de Gaston Vuillier - qu’elle découvre au tout début du XXe siècle parallèlement à ses retrouvailles avec sa ville natale. Collaboratrice du journal féministe la Fronde, Marcelle Tinayre est l’un des premiers membres du jury du futur prix Femina et en sera la présidente en 1908. cote : MAG.P LIM 54199/1 (Bfm Limoges)
Avant l'amour Premier roman de Marcelle Tinayre publié pour la première fois en 1897. Née à Tulle en 1870, Marcelle Tinayre est une femme de lettres qui a marqué la Belle Époque, à la charnière des XIXe et XXe siècles. Fille et belle-fille de femmes engagées, Marcelle Tinayre connaît, après la publication de ses premières nouvelles en 1893, un succès rapide dès ce premier roman, "Avant l’amour ". Elle publie par la suite "Hellé", couronné par l’Académie française. Parmi ses autres œuvres, il convient de citer "la Rebelle", paru en 1905, dans lequel elle aborde l’avortement ; elle parle de grossesses hors-mariage dans son second roman « corrézien » la "Vie amoureuse de François Barbazanges" puis "l’Ombre de l’amour" (1909), dont l’action se déroule principalement à Gimel-les-Cascades. séduite par ce bourg - à l'instar de Gaston Vuillier - qu’elle découvre au tout début du XXe siècle parallèlement à ses retrouvailles avec sa ville natale. Collaboratrice du journal féministe la Fronde, Marcelle Tinayre est l’un des premiers membres du jury du futur prix Femina et en sera la présidente en 1908. cote : MAG.P LIM 54199/1 (Bfm Limoges)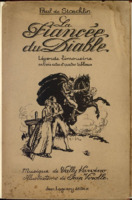 La Fiancée du diable : légende limousine en trois actes et quatre tableaux d'après une nouvelle de Louis de Beaugency . "La Fiancée du Diable a été représentée pour la première fois sur la scène du théâtre municipal de Limoges le 11 janvier 1941." Livret complet et partitions en fin de recueil. Wally Karveno, née Loewenthal est une compositrice comédienne et poétesse qui vécut un temps réfugiée à Limoges pendant la guerre avant d'être internée au camp de Gurs en France en 1941. Elle laisse une oeuvre essentiellement écrite pour piano. Ami de Robert Margerit, du porcelainier Jacques Bernardaud, de l'éditeur Jean Lagueny, etc., Jean Virolle, formé aux beaux-arts de Limoges, est un artiste à plusieurs facettes surtout connu pour ses illustrations de presse et revues. cote : MAG.P LIM 36654
La Fiancée du diable : légende limousine en trois actes et quatre tableaux d'après une nouvelle de Louis de Beaugency . "La Fiancée du Diable a été représentée pour la première fois sur la scène du théâtre municipal de Limoges le 11 janvier 1941." Livret complet et partitions en fin de recueil. Wally Karveno, née Loewenthal est une compositrice comédienne et poétesse qui vécut un temps réfugiée à Limoges pendant la guerre avant d'être internée au camp de Gurs en France en 1941. Elle laisse une oeuvre essentiellement écrite pour piano. Ami de Robert Margerit, du porcelainier Jacques Bernardaud, de l'éditeur Jean Lagueny, etc., Jean Virolle, formé aux beaux-arts de Limoges, est un artiste à plusieurs facettes surtout connu pour ses illustrations de presse et revues. cote : MAG.P LIM 36654 La maison Treilhard, Brive Gravure extraite de " En Limousin, recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage". La maison Treilhard, un bel hôtel particulier du XVIe siècle, fut la maison natale de J.-B. Treilhard (1742-1810), avocat, homme politique, principal rédacteur du code civil. Il est inhumé au Panthéon. Cet immeuble a appartenu aussi à une congrégation des frères prêcheurs. On voit encore la belle tour d’escalier en vis et la tourelle en encorbellement qui s’y accroche. Cette gravure fut initialement publiée dans le Bulletin de la société archéologique de Brive cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)
La maison Treilhard, Brive Gravure extraite de " En Limousin, recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage". La maison Treilhard, un bel hôtel particulier du XVIe siècle, fut la maison natale de J.-B. Treilhard (1742-1810), avocat, homme politique, principal rédacteur du code civil. Il est inhumé au Panthéon. Cet immeuble a appartenu aussi à une congrégation des frères prêcheurs. On voit encore la belle tour d’escalier en vis et la tourelle en encorbellement qui s’y accroche. Cette gravure fut initialement publiée dans le Bulletin de la société archéologique de Brive cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)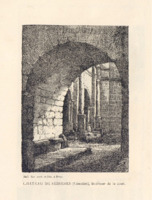 Cour du château de Sédières, Corrèze Gravure extraite de " En Limousin" recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage. Manoir fortifié construit au XVe siècle, il devient au XVIe siècle une demeure de plaisance remaniée de style Renaissance italienne par Dominique de Sédières de retour des campagnes d'Italie. Au XVIIe siècle le château se dote de jardins à la française grâce à la famille Lantillac, nouveaux héritiers des lieux. Abandonné puis pillé à la Révolution, le château est restauré en 1861 suivant les plans de Viollet-le-Duc. Cette gravure fut initialement publiée dans le Bulletin de la société archéologique de Brive cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)
Cour du château de Sédières, Corrèze Gravure extraite de " En Limousin" recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage. Manoir fortifié construit au XVe siècle, il devient au XVIe siècle une demeure de plaisance remaniée de style Renaissance italienne par Dominique de Sédières de retour des campagnes d'Italie. Au XVIIe siècle le château se dote de jardins à la française grâce à la famille Lantillac, nouveaux héritiers des lieux. Abandonné puis pillé à la Révolution, le château est restauré en 1861 suivant les plans de Viollet-le-Duc. Cette gravure fut initialement publiée dans le Bulletin de la société archéologique de Brive cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)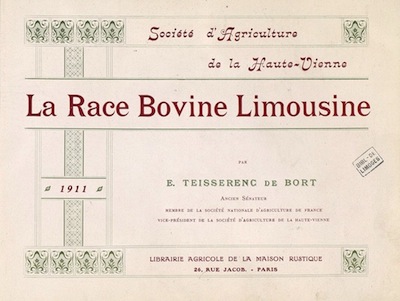 La Race bovine limousine Catalogue illustré des plus beaux spécimens, lieux d'élevage, prix, exposition, etc. précédé d'une courte présentation. Edmond Teisserenc de Bort, sénateur de la Haute-Vienne de 1895 à 1909 consacra la majeure partie de sa vie à la promotion de la race bovine limousine. Il fut président de la société d'agriculture de Limoges, président du syndicat des agriculteurs de la Haute-Vienne et vice-président du syndicat de la race bovine limousine. cote : MAG.P LIM 42885 (Bfm Limoges)
La Race bovine limousine Catalogue illustré des plus beaux spécimens, lieux d'élevage, prix, exposition, etc. précédé d'une courte présentation. Edmond Teisserenc de Bort, sénateur de la Haute-Vienne de 1895 à 1909 consacra la majeure partie de sa vie à la promotion de la race bovine limousine. Il fut président de la société d'agriculture de Limoges, président du syndicat des agriculteurs de la Haute-Vienne et vice-président du syndicat de la race bovine limousine. cote : MAG.P LIM 42885 (Bfm Limoges) Le logis de Loyac, Tulle Gravure extraite de " En Limousin" recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage. Le logis de Loyac appelée aussi "maison de l'abbé" fut construit aux XVe et XVIe siècles. Remarquable par l'élégance de sa façade, cette dernière, reconnaissable à ses tourelles, associe le style gothique flamboyant aux ornementations Renaissance. Cette gravure fut initialement publiée dans "Le vieux Tulle de René Fage. cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)
Le logis de Loyac, Tulle Gravure extraite de " En Limousin" recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage. Le logis de Loyac appelée aussi "maison de l'abbé" fut construit aux XVe et XVIe siècles. Remarquable par l'élégance de sa façade, cette dernière, reconnaissable à ses tourelles, associe le style gothique flamboyant aux ornementations Renaissance. Cette gravure fut initialement publiée dans "Le vieux Tulle de René Fage. cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges) Lexique limousin d'après les oeuvres de Joseph Roux Dans la préface à l'ouvrage, Raymond Laborde précise : " On trouvera donc ici le vrai dialecte limousin et la plupart des mots réapparaitront avec toute leur couleur et leur saveur dégagés de la chrysalide "patoise"[...] Qu'on ne s'attende pas à quelque chose d'impeccable. Notre langue, si longtemps souveraine, a été d'une richesse incomparable. Nous ne pouvions pas avoir la prétention de la faire connaître du premier coup". Joseph Roux (1834-1905) félibre majoral limousin, chanoine de la cathédrale de Tulle, fondateur de la revue occitane Lemouzi est aujourd'hui salué avec respect dans toute l'Occitanie. Auteur d'une oeuvre littéraire riche (certaines de ses œuvres sont de véritables chansons de geste) et d'une Grammaire limousine, il entreprend un dictionnaire de la langue d'oc qui demeurera inédit à sa mort. cote : MAG.P LIM 33684 (Bfm Limoges)
Lexique limousin d'après les oeuvres de Joseph Roux Dans la préface à l'ouvrage, Raymond Laborde précise : " On trouvera donc ici le vrai dialecte limousin et la plupart des mots réapparaitront avec toute leur couleur et leur saveur dégagés de la chrysalide "patoise"[...] Qu'on ne s'attende pas à quelque chose d'impeccable. Notre langue, si longtemps souveraine, a été d'une richesse incomparable. Nous ne pouvions pas avoir la prétention de la faire connaître du premier coup". Joseph Roux (1834-1905) félibre majoral limousin, chanoine de la cathédrale de Tulle, fondateur de la revue occitane Lemouzi est aujourd'hui salué avec respect dans toute l'Occitanie. Auteur d'une oeuvre littéraire riche (certaines de ses œuvres sont de véritables chansons de geste) et d'une Grammaire limousine, il entreprend un dictionnaire de la langue d'oc qui demeurera inédit à sa mort. cote : MAG.P LIM 33684 (Bfm Limoges) Maison à Uzerche, Corrèze Gravure extraite de " En Limousin, recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage". Cette maison est connue aujourd'hui sous le nom de Château Pontier. C'est un bâtiment construit au 16e siècle par la famille Pontier qui avait quitté Aix-en-Provence à cause des guerres de Religion. Construit à l'emplacement d'un château antérieur, le bâtiment est constitué d' un corps de logis rectangulaire flanqué, du côté de la Vézère, de deux tourelles circulaires d'angle. Cette gravure fut initialement publiée dans le Bulletin de la société archéologique de Brive cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)
Maison à Uzerche, Corrèze Gravure extraite de " En Limousin, recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage". Cette maison est connue aujourd'hui sous le nom de Château Pontier. C'est un bâtiment construit au 16e siècle par la famille Pontier qui avait quitté Aix-en-Provence à cause des guerres de Religion. Construit à l'emplacement d'un château antérieur, le bâtiment est constitué d' un corps de logis rectangulaire flanqué, du côté de la Vézère, de deux tourelles circulaires d'angle. Cette gravure fut initialement publiée dans le Bulletin de la société archéologique de Brive cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)
