-
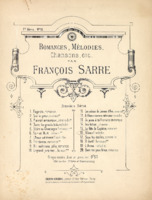 Viens !
Viens ! Mélodie pour piano.
Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud.
Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps.
François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. il publie d'ailleurs une méthode de solfège.
cote : MAG.P LIM PAR.84 (Bfm Limoges)
-
 La Légende du roi Aigolant et les origines de Limoges
La Légende du roi Aigolant et les origines de Limoges Extrait du Bulletin historique et philologique, 1902.
Alfred Leroux recense et étudie les sources de ce beau conte du XIVe siècle qui parle d'un roi sarrasin venu à Limoges au IXe siècle et qui fit construire un aqueduc souterrain ainsi qu' une fontaine, la fameuse fontaine d'Aigoulène....
cote : MAG.P LIM 40940 (Bfm Limoges)
-
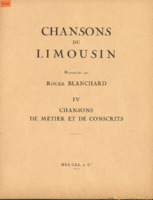 Chansons du Limousin ; 4 : chansons de métier et de conscrits
Chansons du Limousin ; 4 : chansons de métier et de conscrits Contient les chansons suivantes : 1. Les scieurs de long 2. Le rémouleur 3. Le cordonnier, Lou courdounier 4. Les bouchers 5. C'est les garçons du Limousin 6. Je me suis t'engagé.
cote : MAG.P LIM PAR.10
-
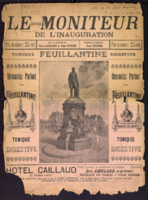 Le Moniteur de l'inauguration (du monument Sadi Carnot)
Le Moniteur de l'inauguration (du monument Sadi Carnot) Biographie de Sadi Carnot et programme des fêtes d'inauguration des 24 et 25 juillet 1897.
cote : Mag.P LIM K137 (Bfm Limoges)
-
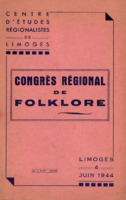 Congrès régional de Folklore
Congrès régional de Folklore Compte-rendu de la journée d'études organisée le 4 juin 1944 à Limoges par le Centre d'Etudes Régionalistes de Limoges. On y trouve des allocutions des plus grands érudits locaux de l'époque : Franck Delage, René Farnier, Marguerite Genès, Antoine Perrier, Louis de Nussac, Jean Rebier, etc.
cote : Mag P LIM 50295 (Bfm Limoges)
-
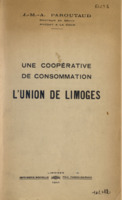 Une coopérative de consommation de Limoges
Une coopérative de consommation de Limoges L’Union de Limoges apparue en 1881 est une des plus importantes société de secours mutuel apparue à Limoges avec l'essor du mouvement ouvrier.
En 1935 elle fédère 25% de la population totale de la cité. La société achète à bas prix les denrées, les vend dans son propre réseau de distribution, abaissant ainsi le prix de revient des produits. Au fil des années, l'Union devient une véritable entreprise agro-alimentaire avec son fournil, sa biscuiterie, ses chais et même son propre élevage à la ferme du Mas-Eloi. Elle emploie, en 1939, 490 personnes. L’Union s’affirme également comme l’un des vecteurs de l’éducation populaire. Elle bâtit sa salle de spectacle et de réunion et met à disposition une bibliothèque riche de 13.000 ouvrages en 1939. Caisse de retraite, congés maladie pour son personnel, colonies de vacances… contribuent à faire de l’Union un acteur puissant en vue d’améliorer la condition de la population ouvrière limougeaude.
JM .A Paroutaud livre une étude détaillée et chiffrée du fonctionnement de cette institution locale.
cote : MAG.P LIM 50294 (Bfm Limoges)
-
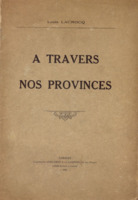 A travers nos provinces
A travers nos provinces Recueil des articles de Louis Lacrocq parus dans le "Courrier du Centre" et le "Limousin de Paris" entre 1923 et 1928. L'auteur évoque des faits et des personnages, des monuments, des coutumes, des artistes des provinces de la Marche, Berry, Limousin, Quercy, Périgord, Angoumois.
Avocat à Guéret, président de la vénérable société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, Louis Lacrocq est dans la pure tradition des érudits locaux du XIXe siècle, passionné d'histoire et d'archéologie.
Outre ses articles, on lit doit notamment un livre exhaustif sur les monuments religieux de la Creuse : Églises de France. Creuse, (ed. Letouzey et Ané, 1934), ouvrage qui fait toujours autorité.
cote : MAG.P LIM 33358 (Bfm Limoges)
-
 Lou gru que leva : Pessa lemouzina en dous ates
Lou gru que leva : Pessa lemouzina en dous ates "René Farnier, majoral du Félibrige, auteur d’innombrables articles sur la région, sur sa langue, ses traditions, a fait jouer une douzaine de ses pièces entre 1923 et sa mort en 1953. Lou gru que leva (Le grain qui lève) est créée pour la première fois par la troupe théâtrale de l’Eicola dau Barbichet, le 27 mai 1928 à la salle de l’Union, rue des Coopérateurs, à l’occasion de la sainte Estelle (grand congrès annuel du Félibrige) organisée cette année-là à Limoges. Véritable œuvre de propagande pour la défense de la langue d’oc limousine, la pièce confronte le monde paysan et Bidounet, qui a « réussi à la ville » et qui présente son fils, Arsène, qui ne parle pas occitan, à ses cousins et anciens voisins campagnards. Scène de bal, essai de mariage arrangé, jalousies… la pièce met en avant le bon sens, la sagesse, la fidélité, l’honnêteté des paysans face à des vilauds dévoyés et manipulateurs. Les références appuyées à la richesse de la langue, de la culture populaire et des traditions sont fréquentes. En témoigne par exemple ce passage de la scène 7 de l’acte 2, longue tirade du brave Marsau (Martial), jeune paysan qui répond à Bidounet, le parvenu qui leur proposait de « leur amener la civilisation de la ville » : « Nous pouvons passer devant les bourgeois parce que nous-autres sommes des nobles enracinés dans notre terre. Vous nous parliez de civilisation, Monsieur Bidounet, nous sommes de taille à la faire tout seuls, mais ce ne sera pas une civilisation empruntée, ce sera la nôtre, la civilisation paysanne qui ne demande rien à personne. Pour cela, nous n’avons qu’à rester paysan, seulement paysan en notre terre, en notre langue, nos danses, nos traditions. Ici, vous-autres les beaux messieurs de la ville, il vous faudra vous prosterner devant nous ». Le message de Farnier est fort, même politique. La langue qu’il utilise est simple, belle, ne cède pas aux « francismes », emploie de vieux mots limousins sans être trop littéraire. Une illustration parfaite de l’œuvre félibréenne de l’entre-deux-guerres.
René Farnier est né le 21 mai 1888 en Haute-Savoie, de parents originaires de Bonnac-la-Côte en Haute-Vienne. Son père est ingénieur-constructeur dans les chemins de fer. Il vit ses premières années à Largentière (Drôme) puis en Provence. A l’adolescence, son père ayant pris sa retraite, la famille s’installe à Limoges, en haut du boulevard Gambetta, en face de chez ses oncle et tante Nivet, grainetiers. Il poursuit sa scolarité au lycée Gay-Lussac, en ce début de 20e siècle où l’histoire régionale et la langue d’oc sont promues par de nombreux professeurs. C’est l’époque du prix Nobel de Frédéric Mistral pour son poème "Mirèio".
René Farnier a pour professeur Franck Delage, il fréquente entre autres Léon Delhoume, Evariste Mazeaud, Edmond Descubes, avec lesquels il publie une feuille littéraire au lycée. René Farnier part ensuite « faire son droit » à Paris. Là, il rencontre de nombreux « méridionaux », dont Charles Maurras ou encore Albert Bertrand-Mistral, neveu du grand poète provençal, qui le premier « l’initiera » au Félibrige. Durant ces années passées à Paris, Farnier ne rêve que de restaurer la culture et la langue du Limousin. Mais il est d’abord enrôlé dans l’armée où il vit la terrible guerre des tranchées. Survivant à ses quatre années de guerre, il installe son cabinet d’avocat rue Darnet, à Limoges. Avocat de la S.N.C.F., conseiller de l’Ordre, enseignant à l’Ecole de Droit, élu bâtonnier en 1935, sa carrière d’homme de loi ne fut pas négligeable. Mais c’est avant tout l’activité félibréenne qui occupa sa vie et son esprit. En 1920, il décida avec quelques amis, dont Léon Delhoume et Louis de Nussac, d’unifier les différentes écoles félibréennes du Haut-Limousin (Haute-Vienne, Creuse) et du Bas-Limousin (Corrèze) et que la revue régionaliste Lemouzi, créée une vingtaine d’années plus tôt, ferait le lien entre ces deux pays frères et assurerait la « propagande d’oc » dans tout le Limousin. Tous les grands auteurs régionalistes limousins se côtoient alors dans cette revue : Paul-Louis Grenier, Albert Pestour, Jean Rebier, Joseph Nouaillac, Septime Gorceix, Jean-Baptiste Chèze etc. Le Félibrige limousin s’organise donc, se fédère, et son efficacité en est décuplée."
Baptiste Chrétien.
cote : MAG.P LIM B1646 (Bfm Limoges)
-
 Les Feuillardiers du Limousin et leurs syndicats
Les Feuillardiers du Limousin et leurs syndicats Au XIXe siècle, les Feuillardiers étaient des artisans qui fabriquaient des feuillards, sortes de longues lattes de bois, essentiellement en châtaignier qui servaient notamment à cercler les barriques de bois des vignerons du Bordelais voisin. Ils fabriquaient aussi des piquets, des bardeaux, des lattes, etc. Le métier de feuillardier est apparu dans le Limousin vers les années 1850 lorsque les forges utilisant le charbon de châtaignier ont périclité. La période la plus faste de la profession se situe entre 1880 et 1930. Exercée pendant les mois d'hiver, c'était une activité peu valorisante et difficile. En 1905 les feuillardiers se regroupèrent en syndicat et plusieurs mouvements de grèves eurent lieu qui eurent pour conséquence une légère revalorisation des tarifs. Au final, le syndicat des feuillardiers est un exemple d'une organisation professionnelle puissante en milieu rural avec près de 1500 adhérents avant la guerre de 1914.
cote : MAG.P LIM 30208 (Bfm Limoges)
-
 Variations dans le développement et les aptitudes du bétail limousin, en Corrèze, sous l'influence du milieu naturel et de son amélioration, étude suivie d'un aperçu sur l'état sanitaire du troupeau et les conditions pratiques propres à l'améliorer
Variations dans le développement et les aptitudes du bétail limousin, en Corrèze, sous l'influence du milieu naturel et de son amélioration, étude suivie d'un aperçu sur l'état sanitaire du troupeau et les conditions pratiques propres à l'améliorer Thèse de médecine vétérinaire.
Dédicace manuscrite de l'auteur à Antoine Perrier
Fonds Antoine Perrier.
cote : MAG.P LIM F7150/95 (Bfm Limoges)
-
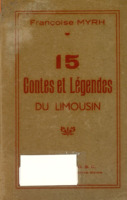 15 contes et légendes du Limousin
15 contes et légendes du Limousin cote : MAG.P LIM 51750 (Bfm Limoges)
-
 De l'idée révolutionnaire [suivi de] La journée de huit heures
De l'idée révolutionnaire [suivi de] La journée de huit heures Court texte de Carolus Fredddi, pseudonyme d'Alfred-Charles Lavauzelle. Fils d'un gros industriel, l'imprimeur limousin Charles Lavauzelle, "il aurait pu se contenter d'être un bon fils de famille, tout entier il entend s'adonner aux lettres qu'il chérit, à la cause du peuple que sa situation et le malheur envié d'être fils de capitaliste l'empêchait de défendre comme il l'aurait voulu" Laurent Tailhade.
cote : MAG.P LIM 15962/q (Bfm Limoges)
-
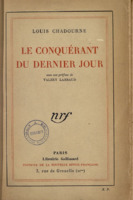 Le conquérant du dernier jour
Le conquérant du dernier jour Nouvelles posthumes, préfacées par Valery Larbaud.
Très tôt, Louis Chadourne, écrit des vers et collabore à la NRF. Valéry Larbaud et Pierre Mac-Orlan voient en lui un des écrivains les plus doués de sa génération.Larbaud allait jusqu'à le définir comme le Conrad français.
En 1919, Louis Chadourne publie son premier roman "Le maître du navire", puis un roman autobiographique "Inquiète adolescence". Brisé par la Première Guerre Mondiale (blessé, il demeura enseveli plusieurs heures) dont il ne se remettra pas, ses textes témoignent de l'extrême fragilité de l'existence et de sa beauté fugace.
cote : MAG.P LIM 15487(Bfm Limoges)
-
 Le géranium ovipare
Le géranium ovipare « Georges Fourest était un poète français à la verve parodique et irrévérencieuse, jouant avec truculence de mots rares ou cocasses, des dissonances de ton, de l’imprévu verbal et métrique, des effets burlesques."
José Corti, "Souvenirs désordonnés".
Né à Limoges en 1867, Georges Fourest suit des études de droit. Il se qualifie ensuite d’avocat "loin de la cour d’appel. A Paris, il fréquente les milieux littéraires symbolistes et décadents, collabore à plusieurs revues (La Connaissance, Le Décadent) et se rend célèbre avec La Négresse blonde (Messein, 1909), préfacé par Willy, et placé sous le patronage de Rabelais. On retrouve dans Le Géranium ovipare cette même atmosphère anticonformiste et truculente.
cote : MAG.P LIM 53627 (Bfm Limoges)
-
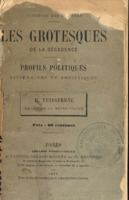 Les Grotesques de la décadence, profils politiques littéraires et artistiques M. Teisserenc, député de la Haute-Vienne
Les Grotesques de la décadence, profils politiques littéraires et artistiques M. Teisserenc, député de la Haute-Vienne Pamphlet contre Pierre-Edmond Tesserenc de Bort, " né à Chateauroux en 1814, chevalier de la Légion d'honneur, administrateur du chemin de fer Lyon-Méditerrannée, député de Versailles, de la Haute-Vienne, membre de la Commission du budget, auteur de brochures ignorées, illisibles et introuvables, etc."
cote : MAG.P LIM 18639 (Bfm Limoges)
-
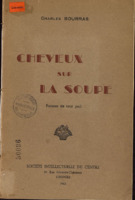 Cheveux sur la soupe : poésies de tout poil
Cheveux sur la soupe : poésies de tout poil Petit recueil souriant de poésies légères et sombres éditées pendant la deuxième Guerre Mondiale.
L'exemplaire comporte un ex-dono de l'éditeur du 3 décembre 1943, l'autre est dédicacé par l'auteur.
cote : MAG.P LIM 50096 (Bfm Limoges)
-
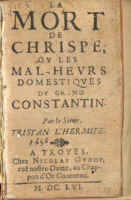 La Mort de Chrispe, ou les malheurs domestiques du Grand Constantin
La Mort de Chrispe, ou les malheurs domestiques du Grand Constantin Pièce tragique de Tristan l'Hermite.
Variation sur le thème du mythe de Phèdre qui connut son heure de gloire au XVIIe siècle : la passion coupable de Fauste, épouse de l'empereur Constantin pour son beau-fils Chrispe. Mais Chrispe aime Constance, qui finira empoisonnée par Fauste...
Ecrite en 1644, cette pièce reçut un accueil mitigé du public, considérée comme moins aboutie de Marianne ou la Mort de Sénèque qui firent le succès tragique de Tristan l'Hermite.
François dit Tristan L'Hermite (1601 Janaillat, Creuse -1655 Paris), fut l’un des poètes lyriques les plus importants de son temps, publiant Les Amours de Tristan (1638), Les Vers héroïques (1648). Tristan l'Hermite entreprit une carrière d'auteur dramatique. Ses tragédies, qui mettaient en scène des caractères vigoureux et épris d'absolu, rencontrèrent le succès et il fut considéré par ses contemporains comme le rival de Corneille.
cote : FA/0-16°/BIB (fonds ancien BM Grand Guéret )
-
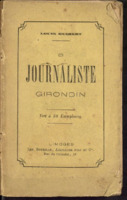 Un Journaliste girondin
Un Journaliste girondin Le récit de la vie d'Antoine-Joseph Gorsas né à Limoges, fils de cordonnier , devenu journaliste pamphlétaire influent pendant la Révolution Française. Elu au Comité de Sûreté nationale, girondin, anti-clérical, ses oppositions farouches aux Montagnards le conduisent à l'échafaud en 1793.
L'auteur, Louis Guibert, pour ses multiples travaux sur sa région natale, le Limousin.
Ouvrage édité à 50 exemplaires.
autographe de l'auteur.
NB : lacunes des pages 7, 10, 11, 30, 31, 94, 95, 100, 101.
Fonds du Séminaire - Bibliothèque Universitaire de Limoges
-
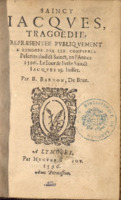 Sainct Jacques, tragoedie repraesentée publiquement à Lymoges
Sainct Jacques, tragoedie repraesentée publiquement à Lymoges Titre complet : Sainct Jacques, tragoedie repraesentée publiquement à Lymoges par les confrères Pélerins dudict sainct en l'année 1596, le jour et feste Sainct Jacques, 25 juillet.
En 1596, Les autorités royales et municipales accueillent officiellement le retour des Ligueurs pour une cérémonie officielle et grandiloquente de réconciliation après les récentes Guerres de Religion.
Pourtant, c'est bien cette année que l'avocat Bernard Bardon de Brun choisit d'écrire sa pièce la "Tragédie de Monsieur Saint Jacques" qui retrace les épisodes majeur de la vie du saint. La pièce, inspirée de la Légende de Saint-Jacques par Jacques de Voragine, est une oeuvre à la gloire de la reconquête catholique : elle dénonce les Huguenots et exalte le catholicisme d'inspiration hispanique qui avait les faveurs des Ligueurs. Jouée une semaine après le retour des Ligueurs par la Confrérie des Pèlerins de Saint-Jacques, cette pièce porte bien les limites de cette réconciliation et la volonté d'une frange de catholique de poursuivre le combat de la Ligue.
cote : RES.P LIM T151 (Bfm limoges)
-
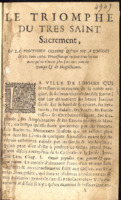 Le Triomphe du Très-Saint Sacrement
Le Triomphe du Très-Saint Sacrement Titre complet :
"Le Triomphe du Très-Saint Sacrement ou la Procession célèbre qu'on fit à Limoges le jour qui finissait l'octave de la Fête-Dieu le 20 juin 1686 : procession qu'on fait tous les ans mais qu'on n'avait plus fait avec tant de pompe et de magnificence."
Dans la longue et riche histoire des confréries limousines, attachées aux joies de l'expiation et de la participation la plus intime aux souffrances du Christ, les Processions sont un point d'orgue. La procession du 20 juin 1686 fit particulièrement date pour sa théâtralité, son luxe et sa magnificence. Ce curieux opuscule publié à Limoges reprend la description précise de cette procession.
A noter : cet ouvrage appartenait à l'abbé Tandeau de Marsac, qui s'attachera à le faire réediter en 1877.
cote : RES.P LIM T149 (Bfm Limoges)
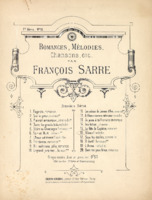 Viens ! Mélodie pour piano. Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud. Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps. François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. il publie d'ailleurs une méthode de solfège. cote : MAG.P LIM PAR.84 (Bfm Limoges)
Viens ! Mélodie pour piano. Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud. Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps. François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. il publie d'ailleurs une méthode de solfège. cote : MAG.P LIM PAR.84 (Bfm Limoges) La Légende du roi Aigolant et les origines de Limoges Extrait du Bulletin historique et philologique, 1902. Alfred Leroux recense et étudie les sources de ce beau conte du XIVe siècle qui parle d'un roi sarrasin venu à Limoges au IXe siècle et qui fit construire un aqueduc souterrain ainsi qu' une fontaine, la fameuse fontaine d'Aigoulène.... cote : MAG.P LIM 40940 (Bfm Limoges)
La Légende du roi Aigolant et les origines de Limoges Extrait du Bulletin historique et philologique, 1902. Alfred Leroux recense et étudie les sources de ce beau conte du XIVe siècle qui parle d'un roi sarrasin venu à Limoges au IXe siècle et qui fit construire un aqueduc souterrain ainsi qu' une fontaine, la fameuse fontaine d'Aigoulène.... cote : MAG.P LIM 40940 (Bfm Limoges)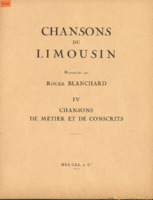 Chansons du Limousin ; 4 : chansons de métier et de conscrits Contient les chansons suivantes : 1. Les scieurs de long 2. Le rémouleur 3. Le cordonnier, Lou courdounier 4. Les bouchers 5. C'est les garçons du Limousin 6. Je me suis t'engagé. cote : MAG.P LIM PAR.10
Chansons du Limousin ; 4 : chansons de métier et de conscrits Contient les chansons suivantes : 1. Les scieurs de long 2. Le rémouleur 3. Le cordonnier, Lou courdounier 4. Les bouchers 5. C'est les garçons du Limousin 6. Je me suis t'engagé. cote : MAG.P LIM PAR.10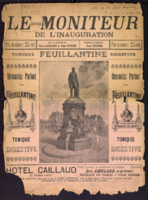 Le Moniteur de l'inauguration (du monument Sadi Carnot) Biographie de Sadi Carnot et programme des fêtes d'inauguration des 24 et 25 juillet 1897. cote : Mag.P LIM K137 (Bfm Limoges)
Le Moniteur de l'inauguration (du monument Sadi Carnot) Biographie de Sadi Carnot et programme des fêtes d'inauguration des 24 et 25 juillet 1897. cote : Mag.P LIM K137 (Bfm Limoges)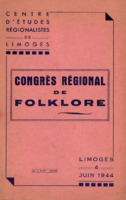 Congrès régional de Folklore Compte-rendu de la journée d'études organisée le 4 juin 1944 à Limoges par le Centre d'Etudes Régionalistes de Limoges. On y trouve des allocutions des plus grands érudits locaux de l'époque : Franck Delage, René Farnier, Marguerite Genès, Antoine Perrier, Louis de Nussac, Jean Rebier, etc. cote : Mag P LIM 50295 (Bfm Limoges)
Congrès régional de Folklore Compte-rendu de la journée d'études organisée le 4 juin 1944 à Limoges par le Centre d'Etudes Régionalistes de Limoges. On y trouve des allocutions des plus grands érudits locaux de l'époque : Franck Delage, René Farnier, Marguerite Genès, Antoine Perrier, Louis de Nussac, Jean Rebier, etc. cote : Mag P LIM 50295 (Bfm Limoges)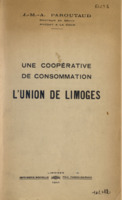 Une coopérative de consommation de Limoges L’Union de Limoges apparue en 1881 est une des plus importantes société de secours mutuel apparue à Limoges avec l'essor du mouvement ouvrier. En 1935 elle fédère 25% de la population totale de la cité. La société achète à bas prix les denrées, les vend dans son propre réseau de distribution, abaissant ainsi le prix de revient des produits. Au fil des années, l'Union devient une véritable entreprise agro-alimentaire avec son fournil, sa biscuiterie, ses chais et même son propre élevage à la ferme du Mas-Eloi. Elle emploie, en 1939, 490 personnes. L’Union s’affirme également comme l’un des vecteurs de l’éducation populaire. Elle bâtit sa salle de spectacle et de réunion et met à disposition une bibliothèque riche de 13.000 ouvrages en 1939. Caisse de retraite, congés maladie pour son personnel, colonies de vacances… contribuent à faire de l’Union un acteur puissant en vue d’améliorer la condition de la population ouvrière limougeaude. JM .A Paroutaud livre une étude détaillée et chiffrée du fonctionnement de cette institution locale. cote : MAG.P LIM 50294 (Bfm Limoges)
Une coopérative de consommation de Limoges L’Union de Limoges apparue en 1881 est une des plus importantes société de secours mutuel apparue à Limoges avec l'essor du mouvement ouvrier. En 1935 elle fédère 25% de la population totale de la cité. La société achète à bas prix les denrées, les vend dans son propre réseau de distribution, abaissant ainsi le prix de revient des produits. Au fil des années, l'Union devient une véritable entreprise agro-alimentaire avec son fournil, sa biscuiterie, ses chais et même son propre élevage à la ferme du Mas-Eloi. Elle emploie, en 1939, 490 personnes. L’Union s’affirme également comme l’un des vecteurs de l’éducation populaire. Elle bâtit sa salle de spectacle et de réunion et met à disposition une bibliothèque riche de 13.000 ouvrages en 1939. Caisse de retraite, congés maladie pour son personnel, colonies de vacances… contribuent à faire de l’Union un acteur puissant en vue d’améliorer la condition de la population ouvrière limougeaude. JM .A Paroutaud livre une étude détaillée et chiffrée du fonctionnement de cette institution locale. cote : MAG.P LIM 50294 (Bfm Limoges)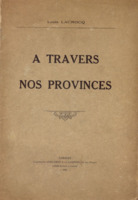 A travers nos provinces Recueil des articles de Louis Lacrocq parus dans le "Courrier du Centre" et le "Limousin de Paris" entre 1923 et 1928. L'auteur évoque des faits et des personnages, des monuments, des coutumes, des artistes des provinces de la Marche, Berry, Limousin, Quercy, Périgord, Angoumois. Avocat à Guéret, président de la vénérable société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, Louis Lacrocq est dans la pure tradition des érudits locaux du XIXe siècle, passionné d'histoire et d'archéologie. Outre ses articles, on lit doit notamment un livre exhaustif sur les monuments religieux de la Creuse : Églises de France. Creuse, (ed. Letouzey et Ané, 1934), ouvrage qui fait toujours autorité. cote : MAG.P LIM 33358 (Bfm Limoges)
A travers nos provinces Recueil des articles de Louis Lacrocq parus dans le "Courrier du Centre" et le "Limousin de Paris" entre 1923 et 1928. L'auteur évoque des faits et des personnages, des monuments, des coutumes, des artistes des provinces de la Marche, Berry, Limousin, Quercy, Périgord, Angoumois. Avocat à Guéret, président de la vénérable société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, Louis Lacrocq est dans la pure tradition des érudits locaux du XIXe siècle, passionné d'histoire et d'archéologie. Outre ses articles, on lit doit notamment un livre exhaustif sur les monuments religieux de la Creuse : Églises de France. Creuse, (ed. Letouzey et Ané, 1934), ouvrage qui fait toujours autorité. cote : MAG.P LIM 33358 (Bfm Limoges) Lou gru que leva : Pessa lemouzina en dous ates "René Farnier, majoral du Félibrige, auteur d’innombrables articles sur la région, sur sa langue, ses traditions, a fait jouer une douzaine de ses pièces entre 1923 et sa mort en 1953. Lou gru que leva (Le grain qui lève) est créée pour la première fois par la troupe théâtrale de l’Eicola dau Barbichet, le 27 mai 1928 à la salle de l’Union, rue des Coopérateurs, à l’occasion de la sainte Estelle (grand congrès annuel du Félibrige) organisée cette année-là à Limoges. Véritable œuvre de propagande pour la défense de la langue d’oc limousine, la pièce confronte le monde paysan et Bidounet, qui a « réussi à la ville » et qui présente son fils, Arsène, qui ne parle pas occitan, à ses cousins et anciens voisins campagnards. Scène de bal, essai de mariage arrangé, jalousies… la pièce met en avant le bon sens, la sagesse, la fidélité, l’honnêteté des paysans face à des vilauds dévoyés et manipulateurs. Les références appuyées à la richesse de la langue, de la culture populaire et des traditions sont fréquentes. En témoigne par exemple ce passage de la scène 7 de l’acte 2, longue tirade du brave Marsau (Martial), jeune paysan qui répond à Bidounet, le parvenu qui leur proposait de « leur amener la civilisation de la ville » : « Nous pouvons passer devant les bourgeois parce que nous-autres sommes des nobles enracinés dans notre terre. Vous nous parliez de civilisation, Monsieur Bidounet, nous sommes de taille à la faire tout seuls, mais ce ne sera pas une civilisation empruntée, ce sera la nôtre, la civilisation paysanne qui ne demande rien à personne. Pour cela, nous n’avons qu’à rester paysan, seulement paysan en notre terre, en notre langue, nos danses, nos traditions. Ici, vous-autres les beaux messieurs de la ville, il vous faudra vous prosterner devant nous ». Le message de Farnier est fort, même politique. La langue qu’il utilise est simple, belle, ne cède pas aux « francismes », emploie de vieux mots limousins sans être trop littéraire. Une illustration parfaite de l’œuvre félibréenne de l’entre-deux-guerres. René Farnier est né le 21 mai 1888 en Haute-Savoie, de parents originaires de Bonnac-la-Côte en Haute-Vienne. Son père est ingénieur-constructeur dans les chemins de fer. Il vit ses premières années à Largentière (Drôme) puis en Provence. A l’adolescence, son père ayant pris sa retraite, la famille s’installe à Limoges, en haut du boulevard Gambetta, en face de chez ses oncle et tante Nivet, grainetiers. Il poursuit sa scolarité au lycée Gay-Lussac, en ce début de 20e siècle où l’histoire régionale et la langue d’oc sont promues par de nombreux professeurs. C’est l’époque du prix Nobel de Frédéric Mistral pour son poème "Mirèio". René Farnier a pour professeur Franck Delage, il fréquente entre autres Léon Delhoume, Evariste Mazeaud, Edmond Descubes, avec lesquels il publie une feuille littéraire au lycée. René Farnier part ensuite « faire son droit » à Paris. Là, il rencontre de nombreux « méridionaux », dont Charles Maurras ou encore Albert Bertrand-Mistral, neveu du grand poète provençal, qui le premier « l’initiera » au Félibrige. Durant ces années passées à Paris, Farnier ne rêve que de restaurer la culture et la langue du Limousin. Mais il est d’abord enrôlé dans l’armée où il vit la terrible guerre des tranchées. Survivant à ses quatre années de guerre, il installe son cabinet d’avocat rue Darnet, à Limoges. Avocat de la S.N.C.F., conseiller de l’Ordre, enseignant à l’Ecole de Droit, élu bâtonnier en 1935, sa carrière d’homme de loi ne fut pas négligeable. Mais c’est avant tout l’activité félibréenne qui occupa sa vie et son esprit. En 1920, il décida avec quelques amis, dont Léon Delhoume et Louis de Nussac, d’unifier les différentes écoles félibréennes du Haut-Limousin (Haute-Vienne, Creuse) et du Bas-Limousin (Corrèze) et que la revue régionaliste Lemouzi, créée une vingtaine d’années plus tôt, ferait le lien entre ces deux pays frères et assurerait la « propagande d’oc » dans tout le Limousin. Tous les grands auteurs régionalistes limousins se côtoient alors dans cette revue : Paul-Louis Grenier, Albert Pestour, Jean Rebier, Joseph Nouaillac, Septime Gorceix, Jean-Baptiste Chèze etc. Le Félibrige limousin s’organise donc, se fédère, et son efficacité en est décuplée." Baptiste Chrétien. cote : MAG.P LIM B1646 (Bfm Limoges)
Lou gru que leva : Pessa lemouzina en dous ates "René Farnier, majoral du Félibrige, auteur d’innombrables articles sur la région, sur sa langue, ses traditions, a fait jouer une douzaine de ses pièces entre 1923 et sa mort en 1953. Lou gru que leva (Le grain qui lève) est créée pour la première fois par la troupe théâtrale de l’Eicola dau Barbichet, le 27 mai 1928 à la salle de l’Union, rue des Coopérateurs, à l’occasion de la sainte Estelle (grand congrès annuel du Félibrige) organisée cette année-là à Limoges. Véritable œuvre de propagande pour la défense de la langue d’oc limousine, la pièce confronte le monde paysan et Bidounet, qui a « réussi à la ville » et qui présente son fils, Arsène, qui ne parle pas occitan, à ses cousins et anciens voisins campagnards. Scène de bal, essai de mariage arrangé, jalousies… la pièce met en avant le bon sens, la sagesse, la fidélité, l’honnêteté des paysans face à des vilauds dévoyés et manipulateurs. Les références appuyées à la richesse de la langue, de la culture populaire et des traditions sont fréquentes. En témoigne par exemple ce passage de la scène 7 de l’acte 2, longue tirade du brave Marsau (Martial), jeune paysan qui répond à Bidounet, le parvenu qui leur proposait de « leur amener la civilisation de la ville » : « Nous pouvons passer devant les bourgeois parce que nous-autres sommes des nobles enracinés dans notre terre. Vous nous parliez de civilisation, Monsieur Bidounet, nous sommes de taille à la faire tout seuls, mais ce ne sera pas une civilisation empruntée, ce sera la nôtre, la civilisation paysanne qui ne demande rien à personne. Pour cela, nous n’avons qu’à rester paysan, seulement paysan en notre terre, en notre langue, nos danses, nos traditions. Ici, vous-autres les beaux messieurs de la ville, il vous faudra vous prosterner devant nous ». Le message de Farnier est fort, même politique. La langue qu’il utilise est simple, belle, ne cède pas aux « francismes », emploie de vieux mots limousins sans être trop littéraire. Une illustration parfaite de l’œuvre félibréenne de l’entre-deux-guerres. René Farnier est né le 21 mai 1888 en Haute-Savoie, de parents originaires de Bonnac-la-Côte en Haute-Vienne. Son père est ingénieur-constructeur dans les chemins de fer. Il vit ses premières années à Largentière (Drôme) puis en Provence. A l’adolescence, son père ayant pris sa retraite, la famille s’installe à Limoges, en haut du boulevard Gambetta, en face de chez ses oncle et tante Nivet, grainetiers. Il poursuit sa scolarité au lycée Gay-Lussac, en ce début de 20e siècle où l’histoire régionale et la langue d’oc sont promues par de nombreux professeurs. C’est l’époque du prix Nobel de Frédéric Mistral pour son poème "Mirèio". René Farnier a pour professeur Franck Delage, il fréquente entre autres Léon Delhoume, Evariste Mazeaud, Edmond Descubes, avec lesquels il publie une feuille littéraire au lycée. René Farnier part ensuite « faire son droit » à Paris. Là, il rencontre de nombreux « méridionaux », dont Charles Maurras ou encore Albert Bertrand-Mistral, neveu du grand poète provençal, qui le premier « l’initiera » au Félibrige. Durant ces années passées à Paris, Farnier ne rêve que de restaurer la culture et la langue du Limousin. Mais il est d’abord enrôlé dans l’armée où il vit la terrible guerre des tranchées. Survivant à ses quatre années de guerre, il installe son cabinet d’avocat rue Darnet, à Limoges. Avocat de la S.N.C.F., conseiller de l’Ordre, enseignant à l’Ecole de Droit, élu bâtonnier en 1935, sa carrière d’homme de loi ne fut pas négligeable. Mais c’est avant tout l’activité félibréenne qui occupa sa vie et son esprit. En 1920, il décida avec quelques amis, dont Léon Delhoume et Louis de Nussac, d’unifier les différentes écoles félibréennes du Haut-Limousin (Haute-Vienne, Creuse) et du Bas-Limousin (Corrèze) et que la revue régionaliste Lemouzi, créée une vingtaine d’années plus tôt, ferait le lien entre ces deux pays frères et assurerait la « propagande d’oc » dans tout le Limousin. Tous les grands auteurs régionalistes limousins se côtoient alors dans cette revue : Paul-Louis Grenier, Albert Pestour, Jean Rebier, Joseph Nouaillac, Septime Gorceix, Jean-Baptiste Chèze etc. Le Félibrige limousin s’organise donc, se fédère, et son efficacité en est décuplée." Baptiste Chrétien. cote : MAG.P LIM B1646 (Bfm Limoges) Les Feuillardiers du Limousin et leurs syndicats Au XIXe siècle, les Feuillardiers étaient des artisans qui fabriquaient des feuillards, sortes de longues lattes de bois, essentiellement en châtaignier qui servaient notamment à cercler les barriques de bois des vignerons du Bordelais voisin. Ils fabriquaient aussi des piquets, des bardeaux, des lattes, etc. Le métier de feuillardier est apparu dans le Limousin vers les années 1850 lorsque les forges utilisant le charbon de châtaignier ont périclité. La période la plus faste de la profession se situe entre 1880 et 1930. Exercée pendant les mois d'hiver, c'était une activité peu valorisante et difficile. En 1905 les feuillardiers se regroupèrent en syndicat et plusieurs mouvements de grèves eurent lieu qui eurent pour conséquence une légère revalorisation des tarifs. Au final, le syndicat des feuillardiers est un exemple d'une organisation professionnelle puissante en milieu rural avec près de 1500 adhérents avant la guerre de 1914. cote : MAG.P LIM 30208 (Bfm Limoges)
Les Feuillardiers du Limousin et leurs syndicats Au XIXe siècle, les Feuillardiers étaient des artisans qui fabriquaient des feuillards, sortes de longues lattes de bois, essentiellement en châtaignier qui servaient notamment à cercler les barriques de bois des vignerons du Bordelais voisin. Ils fabriquaient aussi des piquets, des bardeaux, des lattes, etc. Le métier de feuillardier est apparu dans le Limousin vers les années 1850 lorsque les forges utilisant le charbon de châtaignier ont périclité. La période la plus faste de la profession se situe entre 1880 et 1930. Exercée pendant les mois d'hiver, c'était une activité peu valorisante et difficile. En 1905 les feuillardiers se regroupèrent en syndicat et plusieurs mouvements de grèves eurent lieu qui eurent pour conséquence une légère revalorisation des tarifs. Au final, le syndicat des feuillardiers est un exemple d'une organisation professionnelle puissante en milieu rural avec près de 1500 adhérents avant la guerre de 1914. cote : MAG.P LIM 30208 (Bfm Limoges) Variations dans le développement et les aptitudes du bétail limousin, en Corrèze, sous l'influence du milieu naturel et de son amélioration, étude suivie d'un aperçu sur l'état sanitaire du troupeau et les conditions pratiques propres à l'améliorer Thèse de médecine vétérinaire. Dédicace manuscrite de l'auteur à Antoine Perrier Fonds Antoine Perrier. cote : MAG.P LIM F7150/95 (Bfm Limoges)
Variations dans le développement et les aptitudes du bétail limousin, en Corrèze, sous l'influence du milieu naturel et de son amélioration, étude suivie d'un aperçu sur l'état sanitaire du troupeau et les conditions pratiques propres à l'améliorer Thèse de médecine vétérinaire. Dédicace manuscrite de l'auteur à Antoine Perrier Fonds Antoine Perrier. cote : MAG.P LIM F7150/95 (Bfm Limoges)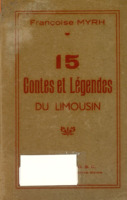 15 contes et légendes du Limousin cote : MAG.P LIM 51750 (Bfm Limoges)
15 contes et légendes du Limousin cote : MAG.P LIM 51750 (Bfm Limoges) De l'idée révolutionnaire [suivi de] La journée de huit heures Court texte de Carolus Fredddi, pseudonyme d'Alfred-Charles Lavauzelle. Fils d'un gros industriel, l'imprimeur limousin Charles Lavauzelle, "il aurait pu se contenter d'être un bon fils de famille, tout entier il entend s'adonner aux lettres qu'il chérit, à la cause du peuple que sa situation et le malheur envié d'être fils de capitaliste l'empêchait de défendre comme il l'aurait voulu" Laurent Tailhade. cote : MAG.P LIM 15962/q (Bfm Limoges)
De l'idée révolutionnaire [suivi de] La journée de huit heures Court texte de Carolus Fredddi, pseudonyme d'Alfred-Charles Lavauzelle. Fils d'un gros industriel, l'imprimeur limousin Charles Lavauzelle, "il aurait pu se contenter d'être un bon fils de famille, tout entier il entend s'adonner aux lettres qu'il chérit, à la cause du peuple que sa situation et le malheur envié d'être fils de capitaliste l'empêchait de défendre comme il l'aurait voulu" Laurent Tailhade. cote : MAG.P LIM 15962/q (Bfm Limoges)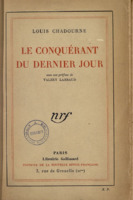 Le conquérant du dernier jour Nouvelles posthumes, préfacées par Valery Larbaud. Très tôt, Louis Chadourne, écrit des vers et collabore à la NRF. Valéry Larbaud et Pierre Mac-Orlan voient en lui un des écrivains les plus doués de sa génération.Larbaud allait jusqu'à le définir comme le Conrad français. En 1919, Louis Chadourne publie son premier roman "Le maître du navire", puis un roman autobiographique "Inquiète adolescence". Brisé par la Première Guerre Mondiale (blessé, il demeura enseveli plusieurs heures) dont il ne se remettra pas, ses textes témoignent de l'extrême fragilité de l'existence et de sa beauté fugace. cote : MAG.P LIM 15487(Bfm Limoges)
Le conquérant du dernier jour Nouvelles posthumes, préfacées par Valery Larbaud. Très tôt, Louis Chadourne, écrit des vers et collabore à la NRF. Valéry Larbaud et Pierre Mac-Orlan voient en lui un des écrivains les plus doués de sa génération.Larbaud allait jusqu'à le définir comme le Conrad français. En 1919, Louis Chadourne publie son premier roman "Le maître du navire", puis un roman autobiographique "Inquiète adolescence". Brisé par la Première Guerre Mondiale (blessé, il demeura enseveli plusieurs heures) dont il ne se remettra pas, ses textes témoignent de l'extrême fragilité de l'existence et de sa beauté fugace. cote : MAG.P LIM 15487(Bfm Limoges) Le géranium ovipare « Georges Fourest était un poète français à la verve parodique et irrévérencieuse, jouant avec truculence de mots rares ou cocasses, des dissonances de ton, de l’imprévu verbal et métrique, des effets burlesques." José Corti, "Souvenirs désordonnés". Né à Limoges en 1867, Georges Fourest suit des études de droit. Il se qualifie ensuite d’avocat "loin de la cour d’appel. A Paris, il fréquente les milieux littéraires symbolistes et décadents, collabore à plusieurs revues (La Connaissance, Le Décadent) et se rend célèbre avec La Négresse blonde (Messein, 1909), préfacé par Willy, et placé sous le patronage de Rabelais. On retrouve dans Le Géranium ovipare cette même atmosphère anticonformiste et truculente. cote : MAG.P LIM 53627 (Bfm Limoges)
Le géranium ovipare « Georges Fourest était un poète français à la verve parodique et irrévérencieuse, jouant avec truculence de mots rares ou cocasses, des dissonances de ton, de l’imprévu verbal et métrique, des effets burlesques." José Corti, "Souvenirs désordonnés". Né à Limoges en 1867, Georges Fourest suit des études de droit. Il se qualifie ensuite d’avocat "loin de la cour d’appel. A Paris, il fréquente les milieux littéraires symbolistes et décadents, collabore à plusieurs revues (La Connaissance, Le Décadent) et se rend célèbre avec La Négresse blonde (Messein, 1909), préfacé par Willy, et placé sous le patronage de Rabelais. On retrouve dans Le Géranium ovipare cette même atmosphère anticonformiste et truculente. cote : MAG.P LIM 53627 (Bfm Limoges)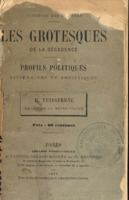 Les Grotesques de la décadence, profils politiques littéraires et artistiques M. Teisserenc, député de la Haute-Vienne Pamphlet contre Pierre-Edmond Tesserenc de Bort, " né à Chateauroux en 1814, chevalier de la Légion d'honneur, administrateur du chemin de fer Lyon-Méditerrannée, député de Versailles, de la Haute-Vienne, membre de la Commission du budget, auteur de brochures ignorées, illisibles et introuvables, etc." cote : MAG.P LIM 18639 (Bfm Limoges)
Les Grotesques de la décadence, profils politiques littéraires et artistiques M. Teisserenc, député de la Haute-Vienne Pamphlet contre Pierre-Edmond Tesserenc de Bort, " né à Chateauroux en 1814, chevalier de la Légion d'honneur, administrateur du chemin de fer Lyon-Méditerrannée, député de Versailles, de la Haute-Vienne, membre de la Commission du budget, auteur de brochures ignorées, illisibles et introuvables, etc." cote : MAG.P LIM 18639 (Bfm Limoges)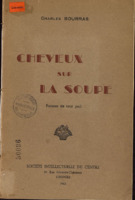 Cheveux sur la soupe : poésies de tout poil Petit recueil souriant de poésies légères et sombres éditées pendant la deuxième Guerre Mondiale. L'exemplaire comporte un ex-dono de l'éditeur du 3 décembre 1943, l'autre est dédicacé par l'auteur. cote : MAG.P LIM 50096 (Bfm Limoges)
Cheveux sur la soupe : poésies de tout poil Petit recueil souriant de poésies légères et sombres éditées pendant la deuxième Guerre Mondiale. L'exemplaire comporte un ex-dono de l'éditeur du 3 décembre 1943, l'autre est dédicacé par l'auteur. cote : MAG.P LIM 50096 (Bfm Limoges)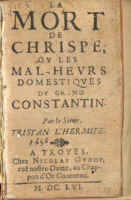 La Mort de Chrispe, ou les malheurs domestiques du Grand Constantin Pièce tragique de Tristan l'Hermite. Variation sur le thème du mythe de Phèdre qui connut son heure de gloire au XVIIe siècle : la passion coupable de Fauste, épouse de l'empereur Constantin pour son beau-fils Chrispe. Mais Chrispe aime Constance, qui finira empoisonnée par Fauste... Ecrite en 1644, cette pièce reçut un accueil mitigé du public, considérée comme moins aboutie de Marianne ou la Mort de Sénèque qui firent le succès tragique de Tristan l'Hermite. François dit Tristan L'Hermite (1601 Janaillat, Creuse -1655 Paris), fut l’un des poètes lyriques les plus importants de son temps, publiant Les Amours de Tristan (1638), Les Vers héroïques (1648). Tristan l'Hermite entreprit une carrière d'auteur dramatique. Ses tragédies, qui mettaient en scène des caractères vigoureux et épris d'absolu, rencontrèrent le succès et il fut considéré par ses contemporains comme le rival de Corneille. cote : FA/0-16°/BIB (fonds ancien BM Grand Guéret )
La Mort de Chrispe, ou les malheurs domestiques du Grand Constantin Pièce tragique de Tristan l'Hermite. Variation sur le thème du mythe de Phèdre qui connut son heure de gloire au XVIIe siècle : la passion coupable de Fauste, épouse de l'empereur Constantin pour son beau-fils Chrispe. Mais Chrispe aime Constance, qui finira empoisonnée par Fauste... Ecrite en 1644, cette pièce reçut un accueil mitigé du public, considérée comme moins aboutie de Marianne ou la Mort de Sénèque qui firent le succès tragique de Tristan l'Hermite. François dit Tristan L'Hermite (1601 Janaillat, Creuse -1655 Paris), fut l’un des poètes lyriques les plus importants de son temps, publiant Les Amours de Tristan (1638), Les Vers héroïques (1648). Tristan l'Hermite entreprit une carrière d'auteur dramatique. Ses tragédies, qui mettaient en scène des caractères vigoureux et épris d'absolu, rencontrèrent le succès et il fut considéré par ses contemporains comme le rival de Corneille. cote : FA/0-16°/BIB (fonds ancien BM Grand Guéret )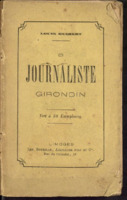 Un Journaliste girondin Le récit de la vie d'Antoine-Joseph Gorsas né à Limoges, fils de cordonnier , devenu journaliste pamphlétaire influent pendant la Révolution Française. Elu au Comité de Sûreté nationale, girondin, anti-clérical, ses oppositions farouches aux Montagnards le conduisent à l'échafaud en 1793. L'auteur, Louis Guibert, pour ses multiples travaux sur sa région natale, le Limousin. Ouvrage édité à 50 exemplaires. autographe de l'auteur. NB : lacunes des pages 7, 10, 11, 30, 31, 94, 95, 100, 101. Fonds du Séminaire - Bibliothèque Universitaire de Limoges
Un Journaliste girondin Le récit de la vie d'Antoine-Joseph Gorsas né à Limoges, fils de cordonnier , devenu journaliste pamphlétaire influent pendant la Révolution Française. Elu au Comité de Sûreté nationale, girondin, anti-clérical, ses oppositions farouches aux Montagnards le conduisent à l'échafaud en 1793. L'auteur, Louis Guibert, pour ses multiples travaux sur sa région natale, le Limousin. Ouvrage édité à 50 exemplaires. autographe de l'auteur. NB : lacunes des pages 7, 10, 11, 30, 31, 94, 95, 100, 101. Fonds du Séminaire - Bibliothèque Universitaire de Limoges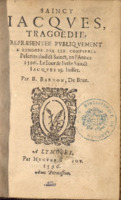 Sainct Jacques, tragoedie repraesentée publiquement à Lymoges Titre complet : Sainct Jacques, tragoedie repraesentée publiquement à Lymoges par les confrères Pélerins dudict sainct en l'année 1596, le jour et feste Sainct Jacques, 25 juillet. En 1596, Les autorités royales et municipales accueillent officiellement le retour des Ligueurs pour une cérémonie officielle et grandiloquente de réconciliation après les récentes Guerres de Religion. Pourtant, c'est bien cette année que l'avocat Bernard Bardon de Brun choisit d'écrire sa pièce la "Tragédie de Monsieur Saint Jacques" qui retrace les épisodes majeur de la vie du saint. La pièce, inspirée de la Légende de Saint-Jacques par Jacques de Voragine, est une oeuvre à la gloire de la reconquête catholique : elle dénonce les Huguenots et exalte le catholicisme d'inspiration hispanique qui avait les faveurs des Ligueurs. Jouée une semaine après le retour des Ligueurs par la Confrérie des Pèlerins de Saint-Jacques, cette pièce porte bien les limites de cette réconciliation et la volonté d'une frange de catholique de poursuivre le combat de la Ligue. cote : RES.P LIM T151 (Bfm limoges)
Sainct Jacques, tragoedie repraesentée publiquement à Lymoges Titre complet : Sainct Jacques, tragoedie repraesentée publiquement à Lymoges par les confrères Pélerins dudict sainct en l'année 1596, le jour et feste Sainct Jacques, 25 juillet. En 1596, Les autorités royales et municipales accueillent officiellement le retour des Ligueurs pour une cérémonie officielle et grandiloquente de réconciliation après les récentes Guerres de Religion. Pourtant, c'est bien cette année que l'avocat Bernard Bardon de Brun choisit d'écrire sa pièce la "Tragédie de Monsieur Saint Jacques" qui retrace les épisodes majeur de la vie du saint. La pièce, inspirée de la Légende de Saint-Jacques par Jacques de Voragine, est une oeuvre à la gloire de la reconquête catholique : elle dénonce les Huguenots et exalte le catholicisme d'inspiration hispanique qui avait les faveurs des Ligueurs. Jouée une semaine après le retour des Ligueurs par la Confrérie des Pèlerins de Saint-Jacques, cette pièce porte bien les limites de cette réconciliation et la volonté d'une frange de catholique de poursuivre le combat de la Ligue. cote : RES.P LIM T151 (Bfm limoges)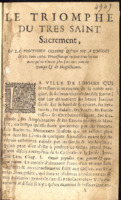 Le Triomphe du Très-Saint Sacrement Titre complet : "Le Triomphe du Très-Saint Sacrement ou la Procession célèbre qu'on fit à Limoges le jour qui finissait l'octave de la Fête-Dieu le 20 juin 1686 : procession qu'on fait tous les ans mais qu'on n'avait plus fait avec tant de pompe et de magnificence." Dans la longue et riche histoire des confréries limousines, attachées aux joies de l'expiation et de la participation la plus intime aux souffrances du Christ, les Processions sont un point d'orgue. La procession du 20 juin 1686 fit particulièrement date pour sa théâtralité, son luxe et sa magnificence. Ce curieux opuscule publié à Limoges reprend la description précise de cette procession. A noter : cet ouvrage appartenait à l'abbé Tandeau de Marsac, qui s'attachera à le faire réediter en 1877. cote : RES.P LIM T149 (Bfm Limoges)
Le Triomphe du Très-Saint Sacrement Titre complet : "Le Triomphe du Très-Saint Sacrement ou la Procession célèbre qu'on fit à Limoges le jour qui finissait l'octave de la Fête-Dieu le 20 juin 1686 : procession qu'on fait tous les ans mais qu'on n'avait plus fait avec tant de pompe et de magnificence." Dans la longue et riche histoire des confréries limousines, attachées aux joies de l'expiation et de la participation la plus intime aux souffrances du Christ, les Processions sont un point d'orgue. La procession du 20 juin 1686 fit particulièrement date pour sa théâtralité, son luxe et sa magnificence. Ce curieux opuscule publié à Limoges reprend la description précise de cette procession. A noter : cet ouvrage appartenait à l'abbé Tandeau de Marsac, qui s'attachera à le faire réediter en 1877. cote : RES.P LIM T149 (Bfm Limoges)
